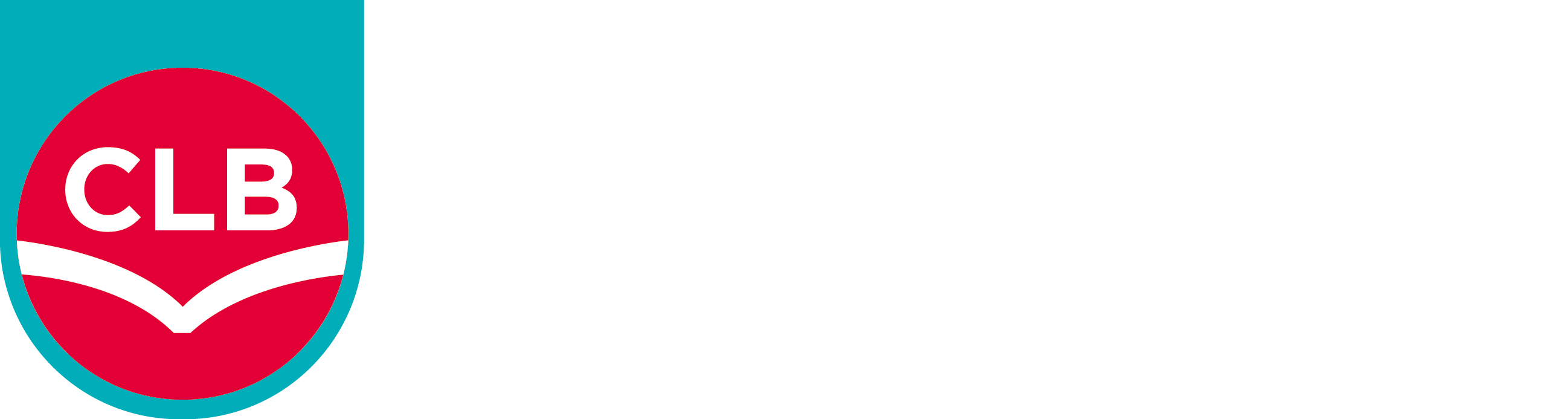Donald COBB, professeur de Nouveau Testament et de grec à la Faculté Jean Calvin, à Aix-en-Provence. Il est auteur du livre L’espérance, comment demain transforme aujourd’hui (collection Question Suivante), paru en 2020, aux éditions Farel-GBU.
La mort ne fait-elle pas partie intégrante de l’expérience humaine ? Tout meurt, après tout. Et tous, nous mourrons. « L’avenir de la vie, c’est la mort ! », disait Nicole Ferroni sur le ton de la dérision dont elle a le secret. En réalité, la mort reste une énigme insoluble, la dissolution de tout ce que nous sommes, un voile impénétrable qui se moque de nos questionnements, de nos exploits et de nos espoirs. Pas étonnant alors que depuis l’aurore de l’humanité, les humains tentent de l’exorciser, d’en pénétrer le secret par la nécromancie, les médiums ou autres, de le fuir ou de l’enfouir.
La mort dans la société matérialiste et les religions orientales
De fait, c’est surtout notre culture « scientifique » qui essaie de se convaincre que derrière ce voile, il n’y a rien, que la mort est simplement la disparition de la vie. J’ai été frappé dernièrement en lisant des réponses de psychologues aux angoisses de quelqu’un qui se disait hanté par la pensée de la mort. Tout en mettant en avant les compétences savantes qui faisaient d’eux des « spécialistes », leurs conseils avisés n’allaient guère plus loin que : « Essayez de ne pas y penser » ! Comme s’il suffisait de nier le problème pour le régler !
Les réponses des grandes religions, orientales en particulier, ne sont pas si différentes. Au risque de friser la caricature, relevons que ces religions, au lieu d’épingler la mort comme un intrus criminel, mettent toute l’existence sensible sur un pied d’égalité avec elle, le tout – la vie autant que la mort – devant être dépassé. Ainsi, dans l’Hindouisme l’existence humaine est maya, une illusion dont il faut s’échapper afin de disparaître dans l’Un (« comme le sel se dissout dans l’eau »). La réincarnation, loin d’être une source d’espérance, prouverait bien plutôt que l’âme ne s’est pas encore dissoute en Brahman (Dieu) mais reste encore enchaînée à une existence individuelle. Dans le Bouddhisme de même – du moins dans ses formes les plus « pures » – l’illumination n’est pas l’accès de l’individu à la félicité mais le début de la disparition de celui-ci dans le Nirvana, le non-être. Face à une réalité marquée par la mort, quelle solution ? S’en extraire.
La perspective biblique
La Bible offre une perspective sur la mort qui tranche aussi bien avec les conceptions matérialistes de l’univers qu’avec les religions orientales.
L’apôtre Paul parle de la mort comme du « dernier ennemi » (1 Co 15,26). La révolte que nous ressentons à la perte d’un être cher, par exemple, est donc une réaction normale face à quelque chose qui ne l’est pas du tout ! Paul précise ailleurs qu’en ce qui concerne les humains la mort n’est rien moins que le « salaire du péché » (Rm 6,23). Il rejoint ainsi la perspective des premiers chapitres de la Genèse : l’homme n’a pas été créé pour la dissolution mais, en vivant dans la communion avec Dieu, pour une vie sans fin (Gn 2,9.17 ; 3,19.22.24). Pas étonnant alors que devant le tombeau de Lazare, Jésus lui-même pleura… avant de libérer son ami des liens de la mort et de le ramener au monde des vivants !
L’évangile de Jean abonde en images qui soulignent que Jésus-Christ est la vie, qu’il est venu dans le monde afin de donner la vie à ceux qui lui appartiennent. Comment comprendre ces affirmations ? Est-ce simplement une façon symbolique de parler de la communion avec Dieu ici ou au ciel ?
La résurrection de Jésus montre qu’il s’agit de bien plus. Paul emploie à plusieurs reprises une expression curieuse : le Christ ressuscité est « prémices » de celles et ceux qui reprendront vie « en lui » (1 Co 15,20-23). Qu’est-ce à dire ? Dans la tradition juive, les prémices étaient les premières gerbes à être récoltées lors de la moisson. Elles ne devançaient pas celle-ci. Au contraire, par elles la moisson débutait réellement. Aussi, parler du Christ comme prémices, c’est dire que, par sa résurrection, la grande « moisson », la résurrection des morts a commencé. Ce qui a eu lieu en Christ, c’est ce qui nous sera donné, à nous aussi, lors de son retour.
De façon tout aussi étonnante, la Bible étend cette perspective à l’univers tout entier ! La création, nous dit-elle, souffre des « douleurs de l’enfantement ». Les tremblements de terre, les inondations et autres phénomènes naturels étaient connus du temps du Nouveau Testament. Au xxie siècle, nous connaissons aussi les ravages que les humains infligent à la nature. Mais pour l’Écriture, la création reste l’œuvre de Dieu, malgré le péché et ses conséquences. C’est pourquoi elle n’est pas destinée à la destruction mais à l’espérance : elle sera « libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu » (Rm 8,20-23) ! Comment Dieu fera-t-il cela ? La Bible ne nous l’explique pas. Mais elle donne le fondement de cette espérance dans un fait historique : la résurrection du corps matériel, physique de Jésus de Nazareth en l’an 30 de notre ère. Ce qui a eu lieu le matin de Pâques vaut pour toute la création !
Conclusion : la mort de la mort
Seule la perspective biblique permet d’affirmer la réalité scandaleuse de la mort, de la disparition des humains créées en image de Dieu pour une communion sans fin. Seul le christianisme est à même de fonder une espérance solide : celle d’un monde où la mort aura été définitivement engloutie par la vie. La mort de la mort ! Il ne s’agit pas là d’un rêve sans consistance réelle, car un jour l’impossible est arrivé : un homme qui gisait dans la tombe depuis plusieurs jours en est sorti vivant, glorifié, immortel et s’est fait voir à des témoins qui se sont mis à le proclamer, parfois au péril de leur vie.
La foi chrétienne nous invite, à notre tour, à être témoins de cette espérance en Christ afin que d’autres aussi puissent connaître la vie qui nous est donnée en lui. Elle nous encourage encore, non seulement à aimer la création de Dieu, mais à nous y investir pleinement, sachant que Dieu nous appelle, non à y échapper mais à en attendre la transformation, à l’image de celui qui a vaincu la mort une fois pour toutes.