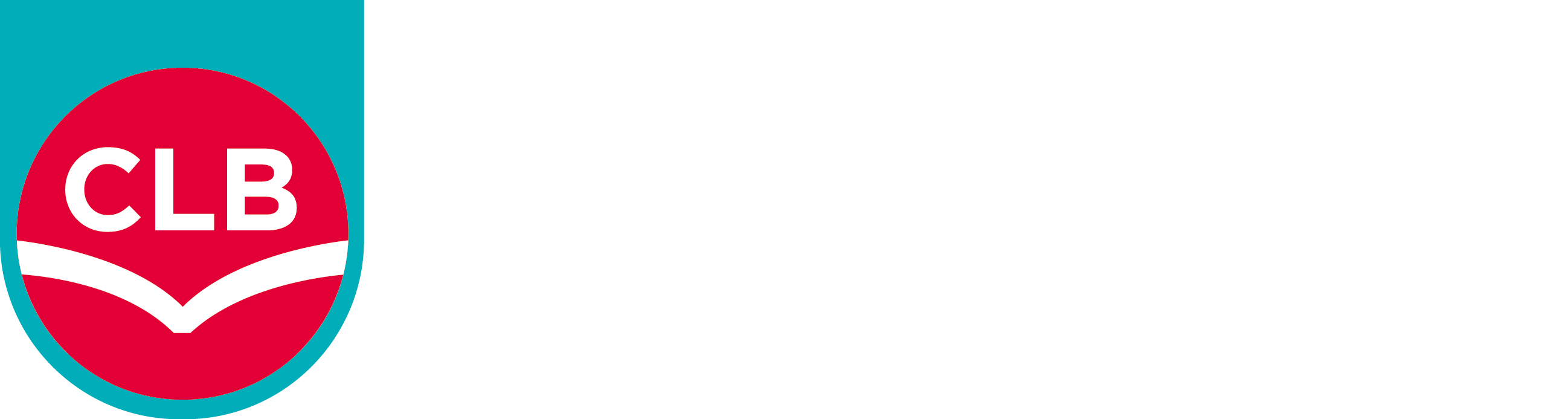L’évolution sociale nous pousse à l’individualisme depuis assez longtemps. Ce processus vient de sources assez diverses et, si on y regarde de près, cela recouvre deux réalités qui sont, en partie, distinctes l’une de l’autre.
Par Frédéric de Coninck, sociologue.
Il faut d’abord souligner que nous vivons dans des cercles sociaux beaucoup plus larges qu’autrefois. Dans une petite ville, tout le monde se connaît et se surveille. Il y a une forte prégnance du corps social et chacun est assigné à une place à laquelle il doit se tenir. Sinon, le rappel à l’ordre est brutal : ragots, jugement moral, ostracisme. Certains sont, finalement, contraints à l’exil. Dans une métropole, la taille fait que l’anonymat domine. Le contrôle social est donc bien moins fort. Chacun peut vivre sa vie à sa guise, du moment qu’il respecte la loi. Nos choix de vie n’intéressent pas nos voisins. Si nous respectons les règles de bon voisinage, cela leur suffit. Donc, chaque individu a une grande liberté. C’est le premier sens de l’individualisme.
Et puis, il y a autre chose que l’effet de taille : nous appartenons à un grand nombre de cercles différents et les personnes que nous fréquentons dans un cercle ignorent souvent ce que nous vivons dans les autres. Il est rare, par exemple, que nous nous retrouvions, à l’université, assis à côté de quelqu’un qui a été à l’école primaire avec nous. Notre famille, notre église, les gens avec qui nous partageons les mêmes goûts musicaux, notre lieu d’études, la matière que nous étudions, nos lieux de loisir le week-end ou l’été, se recoupent parfois. Mais il n’arrive jamais qu’ils se recoupent tous. Et, très vite, nous nous rendons compte que nous sommes la seule personne qui est au carrefour de tous les cercles auxquels nous appartenons. Cela nous donne un sentiment fort de notre singularité. C’est le deuxième sens de l’individualisme.
Liberté individuelle et sentiment de sa singularité : ces deux tendances se sont développées progressivement. Un sociologue allemand, Georg Simmel, les avait déjà remarquées il y a plus de cent ans. Nous en vivons aujourd’hui l’amplification, la pointe avancée.
Il est clair que si l’on appartient à un grand nombre de cercles différents, on se sent moins lié à chacun d’entre eux. On court, également, moins de risques : si les choses se passent mal dans un cercle, on peut toujours se replier sur un autre. Et le fait que l’on soit scruté de moins près rend l’éloignement d’un cercle donné moins dramatique.
Nous vivons donc dans un monde de liens faibles. Est-ce dramatique ? Le sociologue américain Mark Granovetter a créé l’événement en publiant, en 1973, un article qui s’intitulait : « La force des liens faibles »1. Il voulait alors attirer l’attention sur le fait qu’un grand nombre de liens faibles peut produire une société, certes différente, mais aussi solide que celle qui s’appuie sur un petit nombre de liens forts. La thèse est très astucieuse et mérite plus que les quelques lignes de commentaires que j’y consacre ici. Le mieux est de lire vous-même l’article.
Mais deux points aveugles sont à mettre en exergue dans ce type de société. Le premier est que cela masque des grandes inégalités. Les liens sociaux sont cumulatifs : certains les accumulent, en jouent, surfent de l’un à l’autre. D’autres, à l’inverse, se retrouvent exclus d’un grand nombre de cercles et les ruptures succèdent aux ruptures. On sait, par exemple, que les personnes qui ont un emploi ont plus de liens sociaux (sans tenir compte des collègues qu’elles côtoient dans leur travail) que les autres. Il y a peu de ressources pour les perdants du monde embrouillé et peu régulé des liens faibles.
L’autre point aveugle est que la pression mise sur l’individu est énorme. Chacun devient, en quelque sorte, le gestionnaire de sa personne et sa valeur ne lui est assurée par aucun système d’évaluation stable. On ne risque plus la réprobation morale, mais tout simplement le désintérêt. Chacun est dépendant de l’intérêt qu’il suscite, ou pas, dans la multitude des cercles qu’il traverse et il doit, sans cesse, lutter pour sa reconnaissance. Alain Ehrenberg a parlé, à propos de ce phénomène, de la « fatigue d’être soi »2.
J’ai, depuis longtemps, été frappé, à ce propos, par la modernité de la parabole du Bon Samaritain. L’histoire se situe bien dans un univers de liens faibles : les acteurs ne se connaissent pas, ils se croisent de manière fortuite et provisoire. Ce n’est pas là ce qui pose problème. La question que soulève Jésus est celle de savoir qui se préoccupe de celui qui se retrouve au bord de la route, maltraité par les brigands. Le Samaritain s’occupe du blessé de manière temporaire et le confie à l’aubergiste : c’est là ce qui importe. Et quant à la pression mise sur l’individu, Jésus propose un retournement intéressant. La question n’est pas : qui s’intéresse à moi ?, mais : à qui t’intéresses-tu ? Et, de fait, j’ai pu constater que ceux qui s’intéressent aux autres vont, en général, mieux que ceux qui, se préoccupent en permanence de la valeur que les autres leur accordent. (À bon entendeur, salut !)
1Cet article a été traduit en français dans l’ouvrage : Granovetter, Marc, Le marché autrement. Les réseaux dans l’économie, Desclée de Brouwer, 2000
2Alain Ehrenberg, La Fatigue d’être soi – dépression et société, Odile Jacob, 1998.